Ce qui suit est une version étendue de l'article de George Soros "Choix d'Allemagne".
L’objectif de ma venue ici aujourd’hui est d’aborder la crise de l’euro. Au vu des récents événements, je pense que vous serez d’accord sur le fait que cette crise est loin d’être résolue. Elle a d’ores et déjà causé des dommages considérables sur le plan financier et politique, et engendré un impact humain immense. Cette crise a également transformé l’Union européenne en une entité radicalement différente de ce à quoi elle se destinait à l’origine. L’Union européenne a toujours eu pour vocation de constituer une association volontaire d’États égaux, mais la crise l’a changée en un ensemble hiérarchique, chapeauté par l’Allemagne et par d’autres pays créanciers, en charge du sort d’États lourdement endettés, relégués à un statut de deuxième classe. Bien que l’Allemagne ne soit en mesure de dicter une quelconque politique, aucune de ces politiques ne peut en pratique être proposée sans avoir obtenu l’accord préalable de l’Allemagne. Aggravant encore la situation, la politique d’austérité mise en avant par l’Allemagne a pour effet de prolonger la crise et de perpétuer la subordination des pays débiteurs.
Cette situation aboutit à des tensions politiques, comme en témoigne l’impasse politique en Italie. Les Italiens sont désormais en majorité opposés à l’euro, et il est très probable que cette tendance s’accentue. Il existe désormais un réel danger de voir la crise de l’euro finir par anéantir l’Union européenne. Une désintégration désordonnée laisserait l’Europe dans un état encore plus grave qu’à l’époque où fut entreprise cette démarche audacieuse de création d’une Union européenne. Nous assisterions à une tragédie d’ampleur historique. Cette menace ne peut être surmontée qu’à travers le leadership allemand. L’Allemagne n’a jamais souhaité occuper une position dominante, et a toujours été réticente à accepter les responsabilités et les obligations liées à un tel statut. C’est l’une des raisons qui expliquent l’émergence de la situation actuelle. Mais qu’elle le veuille ou non, l’Allemagne est bel et bien aux commandes, et c’est ce qui m’amène à venir m’exprimer ici aujourd’hui.
Comment l’Europe en est-elle arrivée à un tel désastre ? Et comment peut-elle s’en extraire ? Telles sont les deux questions que je souhaite aborder. La réponse à la première de ces interrogations est extrêmement compliquée, compte tenu du caractère profondément complexe de la crise de l’euro. Celle-ci revêt en effet une dimension à la fois politique et financière. Et cette dimension financière se décline elle-même en trois composantes au moins : crise de la dette souveraine, crise bancaire, et écarts de compétitivité. Ces différents aspects sont par ailleurs interconnectés, ce qui soulève des problématiques si épineuses qu’elles en deviennent un véritable casse-tête. Je considère que la crise de l’euro ne peut être pleinement comprise sans prise en compte du rôle considérable qu’ont joué les erreurs et les malentendus dans sa création. Cette crise a en effet été presque entièrement auto-infligée. Elle revêt en ce sens une nature cauchemardesque.
La réponse à la deuxième question est en revanche extrêmement simple. En effet, lorsque les problèmes sont clairement compris, la solution émerge quasiment d’elle-même.
Je développerai les raisons pour lesquelles je considère que l’Allemagne est en grande partie responsable des erreurs de politiques qui ont engendré la crise. Mais j’aimerais d’ores et déjà préciser clairement que je n’entends nullement faire le procès de l’Allemagne. Quiconque aurait été aux affaires aurait commis les mêmes erreurs. Je puis vous affirmer, sur la base de mon expérience personnelle, que nul n’aurait été en mesure de comprendre la situation dans toute sa complexité au moment où elle s’est jouée.
Je réalise pleinement combien je risque de vous contrarier en mettant en cause la responsabilité de l’Allemagne. Mais sachez que seule l’Allemagne est en capacité de régler la situation. Je suis un fervent partisan de l’Union européenne, et je ne souhaite pas la voir disparaître. Je m’inquiète également des souffrances humaines immenses et inutiles qu’entraîne la crise de l’euro, et j’entends faire tout mon possible pour les atténuer. Mon interprétation de la crise de l’euro est par ailleurs tout à fait différente des conceptions qui prévalent en Allemagne. J’espère, en vous suggérant un point de vue différent, pouvoir vous encourager à reconsidérer les vôtres avant que davantage de dégâts ne soient causés. C’est là le but de ma venue parmi vous.
Dès sa création, l’Union européenne fut un projet audacieux suscitant l’enthousiasme dans l’imaginaire de nombreuses personnes, y compris dans le mien. Je considérai l’Union européenne comme l’incarnation d’une société ouverte – une association volontaire d’États égaux cédant une partie de leur souveraineté dans l’objectif du bien commun. L’Union européenne réunissait alors cinq grands États membres accompagnés d’un certain nombre de petits États, tous ces pays embrassant les principes de la démocratie, des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la primauté du droit. Aucune de ces nations ou nationalités n’occupait de position dominante.
Le processus d’intégration fut emmené par une poignée d’hommes d’État visionnaires qui, conscients de l’impossibilité d’atteindre la perfection, pratiquèrent ce que Karl Popper a appelé l’ingénierie sociale fragmentaire. Ils se fixèrent des objectifs limités et des échéances fermes, pour ensuite mobiliser la volonté politique dans le sens d’un petit pas en avant, sachant pertinemment qu’une fois ce pas franchi, son caractère insuffisant apparaîtrait évident et exigerait un pas supplémentaire. Ce processus se nourrit de son propre succès, à la manière d’une séquence d’expansion-récession sur les marchés financiers. C’est ainsi que la Communauté européenne du charbon et de l’acier s’est peu à peu transformée en Union européenne, étape par étape.
La France et l’Allemagne furent en première ligne de cet effort. Lorsque l’empire soviétique commença à se désintégrer, les dirigeants allemands comprirent que la réunification ne serait possible que dans le contexte d’une Europe plus unie, et se préparèrent à faire des sacrifices considérables en ce sens. Lorsqu’il s’agissait de négocier, ils étaient systématiquement disposés à apporter une contribution un peu supérieure et à demander un peu moins que les autres, facilitant ainsi les accords. À l’époque, les responsables politiques allemands affirmaient que l’Allemagne ne menait aucune politique étrangère indépendante, mais seulement une politique étrangère européenne. Ceci permit une accélération exceptionnelle du processus. Un processus qui aboutit à la réunification de l’Allemagne en 1990 et à la ratification du Traité de Maastricht en 1992. S’en suivit une période de consolidation qui perdura jusqu’à la crise financière de 2007-2008.
Malheureusement, le Traité de Maastricht présentait une faille fondamentale. Les architectes de l’euro reconnaissaient qu’il y avait là une construction incomplète : une union monétaire sans union politique. Ces architectes avaient pour autant des raisons de croire que lorsque le besoin s’en ferait sentir, la volonté politique de franchir une nouvelle étape pourrait être mobilisée. Il s’agissait en effet de la manière dont le processus d’intégration avait toujours fonctionné jusqu’à lors.
L’euro revêtait toutefois de nombreuses autres défaillances, dont ni les architectes ni les États membres n’étaient pleinement conscients. Le Traité de Maastricht considérait par exemple comme acquise l’idée que seul le secteur public pourrait produire des déficits chroniques, puisque le secteur privé pourrait toujours être en mesure de corriger ses propres excès. La crise financière de 2007-2008 démentit cette idée. Elle révéla également une défaillance presque fatale dans la construction de l’euro : en créant une banque centrale indépendante, les États membres sont devenus endettés dans une monnaie qu’ils ne contrôlent pas. Ceci les a exposés au risque de défaut.
Les pays développés n’ont aucune raison de connaître un défaut ; ils peuvent toujours imprimer de l’argent. Leur monnaie est susceptible de se déprécier en valeur, mais le risque de défaut est pratiquement inexistant. En revanche, les pays moins développés contraints d’emprunter dans une devise étrangère courent un risque de défaut. Pour aggraver encore la situation, les marchés financiers sont susceptibles de pousser de tels États vers un défaut au travers de raids baissiers. Ce risque de défaut a relégué certains États membres au statut de pays du Tiers monde surendettés dans une devise étrangère.
Avant la crise financière de 2007-2008, autorités et marchés financiers ignoraient cette caractéristique de l’euro. Lorsque l’euro est apparu, les obligations étatiques étaient considérées sans risque. Les régulateurs ont permis aux banques commerciales d’acquérir des obligations étatiques à hauteur de montants illimités, sans mettre de côté aucun capital-risque, et la Banque centrale européenne a accepté toutes les obligations étatiques selon son escompte officiel et en des termes égaux. Ceci a de manière perverse incité les banques commerciales à accumuler les obligations des États membres les plus faibles, soumis à des taux plus élevés dans le but de gagner quelques points de base supplémentaires. Ainsi, les différentiels de taux d’intérêt entre les différentes obligations étatiques ont pratiquement disparu.
Cette convergence des taux d’intérêt a entraîné d’un autre côté une divergence de la performance économique. Les pays qualifiés d’États périphériques, au premier rang desquels l’Espagne et l’Irlande, ont connu des booms de l’immobilier, de l’investissement et de la consommation, qui les ont rendus moins compétitifs, tandis que l’Allemagne, plombée par le coût de la réunification, a initié des réformes structurelles de grande envergure, notamment à l’égard du marché du travail, qui l’ont rendue plus compétitive.
Au cours de la semaine ayant suivi la faillite de Lehman Brothers, les marchés financiers mondiaux ont littéralement cessé de fonctionner, et ont dû être placés sous assistance respiratoire. Il a pour cela été nécessaire de remplacer le crédit des institutions financières à l’égard desquelles la confiance était altérée par un crédit souverain (sous la forme de garanties de la Banque centrale et de déficits budgétaires). Cet accent mis sur la dette souveraine a révélé une caractéristique de l’euro jusqu’à lors ignorée, à savoir le fait qu’en créant une banque centrale indépendante, les États membres de l’euro avaient concédé une partie de leur souveraineté.
Cela aurait été le bon moment pour franchir une étape supplémentaire vers une union budgétaire autant que monétaire, mais la volonté politique a fait défaut. L’Allemagne, tirée vers le bas par le prix de sa réunification, n’était plus à l’avant-garde de l’intégration. La chancelière Merkel a très bien cerné l’opinion publique en affirmant que chaque État devait s’occuper de ses propres institutions financières plutôt que de voir l’Union européenne les gérer de manière collective. Cette période fut celle d’un retour en arrière. Rétrospectivement, elle marqua le début du processus de désintégration.
Plus d’une année fut nécessaire aux marchés financiers pour prendre conscience des implications de la déclaration de la chancelière Merkel, démontrant combien les marchés eux aussi opèrent sur la base de connaissances loin d’être parfaites. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2009, lorsque l’ampleur du déficit grec a été révélée, que les marchés financiers ont réalisé qu’un État membre risquait bel et bien le défaut. Les marchés ont ainsi par vengeance rehaussé les primes de risque à l’égard des États les plus fragiles. Ceci a rendu potentiellement insolvables les banques commerciales dont les bilans étaient remplis de telles obligations, et engendra à la fois une crise de la dette souveraine et une crise bancaire. L’une et l’autre sont en effet aussi liées que deux sœurs jumelles.
Il existe un parallèle étroit entre la crise de l’euro et la crise bancaire internationale de 1982. À l’époque, le FMI et les autorités bancaires internationales avaient sauvé le système bancaire mondial en prêtant juste assez d’argent aux États lourdement endettés pour leur permettre d’échapper au défaut, les poussant toutefois un peu plus vers une dépression durable. L’Amérique latine a, à cet égard, perdu dix ans.
L’Allemagne joue aujourd’hui le même rôle que le FMI à l’époque. Les circonstances sont certes différentes, mais les effets sont les mêmes. Les créanciers déplacent en effet la charge de l’ajustement vers les pays débiteurs, et se dérobent quant à leur responsabilité à l’égard des déséquilibres. Il est intéressant de constater que les termes « centre » et « périphérie » se sont glissés dans l’usage commun de manière presque inaperçue, bien qu’il soit, en termes politiques, clairement inapproprié de décrire l’Italie et l’Espagne comme la périphérie de l’Union européenne. Le fait est, cependant, que l’euro a fait de leurs obligations étatiques des obligations semblables à celles de pays du Tiers monde et susceptibles d’engendrer un défaut. Cet aspect a longtemps été ignoré par les autorités, et n’est encore aujourd’hui pas pleinement admis. C’est là la véritable cause originelle de la crise de l’euro.
Comme ce fut le cas dans les années 1980, toute la critique et toute la charge est retombée sur la « périphérie, » et la responsabilité du « centre » n’a jamais été proprement admise. Les États périphériques se voient reprocher leur manque de discipline budgétaire et d’éthique du travail, mais cela ne suffit pas. Il est certes nécessaire que les États de la périphérie procèdent à des réformes structurelles, comme le fit l’Allemagne après sa réunification. Pour autant, ignorer que l’euro lui-même présente des problèmes structurels qui doivent être corrigés revient à ignorer la cause profonde de la crise de l’euro. C’est pourtant ce à quoi nous assistons.
C’est ici que le terme allemand « Schuld » joue un rôle clé. Comme vous le savez, il signifie à la fois dette, responsabilité, ou encore culpabilité. Son utilisation a rendu naturel – ou « selbstverständlich » – pour l’opinion publique allemande d’accuser les États lourdement endettés de leur propre infortune. Le fait que la Grèce ait manifestement violé les règles a contribué à cet état d’esprit. Or, d’autres États comme l’Espagne et l’Irlande ont joué selon les règles ; il fut un temps où l’Espagne était en effet présentée comme un modèle de vertu. De toute évidence, les fautes sont de nature systémiques, et le malheur des pays lourdement endettés découle en grande partie des règles régissant l’euro. C’est cet argument que j’aimerais faire entendre aujourd’hui.
Selon moi, la « Schuld » ou la responsabilité du « centre » est encore plus grande aujourd’hui qu’elle ne le fut lors de la crise bancaire de 1982. Peut-être était-il été politiquement acceptable en 1982 d’imposer l’austérité aux pays moins développés afin de sauver le système financier international. Pour autant, une telle démarche à l’égard de la zone euro est aujourd’hui incompatible avec cette idée d’une Union européenne qui constituerait une association volontaire d’États égaux. Il existe un conflit insolvable entre ce que dicte la nécessité financière et ce qui est politiquement acceptable. C’est là une question qu’auraient dû aborder les dernières élections italiennes.
La charge de cette responsabilité incombe principalement à l’Allemagne. La Bundesbank a contribué à concevoir le schéma directeur de l’euro, dont les défaillances ont amené l’Allemagne à garder les commandes. Ceci a créé deux problématiques. La première est politique, la seconde financière. C’est la combinaison des deux qui a rendu la situation si épineuse.
La problématique politique réside dans le fait que l’Allemagne n’a jamais souhaité occuper la position dominante qui lui a été conférée, et dans sa réticence à accepter les obligations et les responsabilités attachées à une telle position. L’Allemagne ne souhaite pas jouer le rôle de « tirelire » de l’euro, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle déploie ainsi juste suffisamment d’efforts pour éviter un défaut, mais rien de plus, et lorsque la pression issue des marchés financiers se relâche, elle cherche systématiquement à resserrer les conditions d’octroi d’un tel soutien.
La problématique financière réside quant à elle dans le fait que l’Allemagne impose les mauvaises politiques à la zone euro. L’austérité ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas réduire le fardeau de la dette en réduisant le déficit budgétaire. Le fardeau de la dette est un ratio calculé sur la base de la dette accumulée et du PIB, tous deux exprimés en termes nominaux. Et dans un contexte de demande inadéquate, les réductions budgétaires entraînent une réduction plus que proportionnelle du PIB – en termes techniques, ce que l’on appelle le multiplicateur budgétaire est supérieur à un.
L’opinion publique allemande a du mal à comprendre cela. Les réformes budgétaires et structurelles menées en 2006 par le gouvernement Schroeder ont en effet fonctionné ; pourquoi ne fonctionneraient-elles pas quelques années plus tard pour la zone euro ? La réponse réside dans le fait que l’austérité fonctionne en augmentant les exportations tout en réduisant les importations. Or, lorsque tout le monde effectue la même démarche, cela ne fonctionne tout simplement pas.
La crise de l’euro a atteint son apogée à l’été dernier. Les marchés financiers ont commencé à anticiper une rupture possible, et les primes de risque ont atteint des niveaux écrasants. En dernier recours, la chancelière Merkel a approuvé la nomination du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, contre son propre candidat, Jens Weidmann. Draghi a su saisir tout l’enjeu de la situation. Il a en effet déclaré que la BCE ferait « tout le nécessaire » pour protéger l’euro, une volonté qu’il a appuyée par l’introduction des fameuses OMT. Ceci a rassuré les marchés financiers, qui ont connu un véritable soulagement généralisé. Mais l’euphorie a été de courte durée. Dès lors que la pression des marchés financiers s’est relâchée, l’Allemagne a commencé à revenir sur les promesses qu’elle avait faites au plus haut de la crise.
Dans le cadre du sauvetage de Chypre, l’Allemagne est allée trop loin. Afin de minimiser le coût de ce sauvetage, elle a tenu à ce que les déposants chypriotes soient sollicités pour recapitaliser les banques. Cette décision a été prématurée. Si elle avait été prise après qu’une union bancaire ait été établie et que les banques aient été recapitalisées, il aurait pu s’agir d’une solution saine. Or, cette décision a eu lieu à une période où le système bancaire se retranchait en silos nationaux, et demeurait extrêmement vulnérable. Ce qui s’est passé à Chypre remet en cause le modèle d’entreprise des banques européennes, qui dépendent considérablement des dépôts. Jusqu’à présent, les autorités faisaient tout pour protéger les déposants. Chypre a changé cela. L’attention se concentre sur l’impact du sauvetage de Chypre, or l’impact sur le système bancaire est beaucoup plus important. Les banques vont devoir payer des primes de risque qui affecteront plus lourdement les banques les plus fragiles ainsi que celles des États les plus en difficulté. Le lien insidieux entre le coût de la dette souveraine et la dette bancaire s’en trouvera renforcé. La partie deviendra encore plus inéquitable qu’auparavant.
La chancelière Merkel aurait sans aucun doute souhaité mettre la crise de l’euro en attente au moins jusqu’aux prochaines élections, mais cette crise est de retour en force. L’opinion publique allemande ignore peut-être cela, dans la mesure où Chypre a constitué une victoire politique considérable pour la chancelière Merkel. Aucun pays n’ose défier sa volonté. Par ailleurs, l’Allemagne elle-même demeure relativement peu touchée par la dépression croissante qui envahit la zone euro. Je pense cependant que d’ici les élections, l’Allemagne sera elle aussi entrée en récession, et cela dans la mesure où la politique monétaire menée par la zone euro est en total décalage avec celles des principales autres monnaies. Les acteurs extérieurs procèdent à un assouplissement quantitatif. La Banque du Japon constituait jusqu’à récemment la dernière réticente, mais elle est dernièrement revenue sur ce refus. L’existence d’un yen plus faible, associée à la fébrilité de l’Europe, est vouée à affecter les exportations de l’Allemagne.
Si mon analyse est correcte, une solution simple émerge d’elle-même. Cette solution peut être résumée en un mot : les euro-bonds.
Les euro-bonds ne sont autres que des obligations conjointes et solidaires de tous les États membres. S’il était possible aux États qui se conforment au Pacte budgétaire de convertir l’intégralité de leur stock existant de dette étatique en euro-bonds, l’impact positif serait proche du miracle. Le risque de défaut disparaîtrait, de même que les primes de risque. Les bilans des banques bénéficieraient d’un coup de fouet immédiat, de même que les budgets des États lourdement endettés, dans la mesure où le coût de l’amortissement de leurs stocks de dette étatique existants s’en trouverait réduit. L’Italie, par exemple, pourrait économiser jusqu’à 4 % de son PIB. Son budget s’orienterait vers l’excédent, et, au lieu de l’austérité, le gouvernement pourrait procéder à des mesures de relance budgétaire. L’économie entrerait en croissance et le ratio de la dette diminuerait. La plupart des problèmes à priori insolubles s’évaporeraient littéralement. Seuls les écarts de compétitivité demeureraient non résolus. Il serait toujours nécessaire aux États, dans leur individualité, d’adopter des réformes structurelles, mais la principale défaillance structurelle de l’euro serait réglée. Nous nous réveillerions véritablement de ce cauchemar.
Le Pacte budgétaire établit un certain nombre de remparts adéquats contre le risque qu’implique toute obligation conjointe et solidaire. Conformément à ce Pacte budgétaire, les États auraient la possibilité d’émettre de nouveaux bons et de nouvelles obligations pour remplacer ceux arrivés à maturité, mais rien de plus ; au bout de cinq ans, l’encours de la dette serait progressivement ramené à 60% du PIB. Dans le cas où un État échouerait à se conformer aux règles, il serait alors pénalisé en voyant réduite la quantité d’euro-bonds qu’il lui serait permis d’émettre ; il serait alors nécessaire à cet État d’emprunter le solde en son nom propre, et de verser d’importantes primes de risque.
L’Allemagne s’oppose aux euro-bonds au motif qu’une fois ces euro-bonds introduits, il n’existerait aucune garantie que les États dits périphériques ne violent pas à nouveau les règles. Je considère cette crainte comme infondée. La menace de perdre le privilège d’émission des euro-bonds et de payer de lourdes primes de risque encouragerait en effet puissamment les États à se conformer aux règles. La pénalité serait effectivement si douloureuse qu’il lui faudrait être imposée avec beaucoup de mesure pour ne pas aggraver trop brusquement la position financière d’un État. Dans le même temps, l’autorité budgétaire compétente exercerait des contrôles plus stricts, et toute désobéissance serait punie par de nouvelles réductions du nombre d’euro-bonds pouvant être émis. Aucun gouvernement ne pourrait résister à une telle pression.
Il règne également de larges craintes selon lesquelles les euro-bons seraient de nature à ruiner la cote de crédit de l’Allemagne. Les euro-bonds sont souvent comparés au Plan Marshall. Selon cette comparaison, l’argument voudrait que le Plan Marshall n’ait coûté que quelques points de pourcentage du PIB de l’Amérique alors que les euro-bonds coûteraient en revanche un multiple du PIB de l’Allemagne. Un tel argument revient à comparer des pommes avec des oranges. Le Plan Marshall a en effet constitué une dépense à proprement parler, tandis que les euro-bonds impliquent une garantie de nature à n’être jamais invoquée. Le prix d’une approbation allemande à l’égard des euro-bonds a ainsi été largement exagéré.
Toute garantie a ceci de particulier que plus elle est convaincante, et moins il est probable qu’elle soit invoquée. Les États-Unis ne se sont jamais vus contraints de rembourser la dette encourue lorsqu’ils ont converti la dette des États individuels en obligations fédérales. L’Allemagne a ceci de particulier qu’elle n’entend fournir qu’un effort minimum ; c’est la raison pour laquelle il lui a fallu multiplier ses engagements en escalade, et c’est pourquoi elle est confrontée à des pertes réelles. Le Pacte budgétaire, appuyé par une Autorité budgétaire fonctionnant correctement, permettrait d’éliminer pratiquement tout risque de défaut. La comparaison des euro-bonds avec les obligations américaines, britanniques et japonaises jouerait sur les marchés financiers en faveur des euro-bonds. Certes, l’Allemagne devrait alors payer davantage sur sa propre dette qu’elle ne le fait aujourd’hui, mais les rendements exceptionnellement faibles des Bunds sont un symptôme du mal dont souffre la périphérie. Le bénéfice indirect pour l’Allemagne découlerait du fait qu’une reprise à la périphérie dépasserait de très loin les coûts supplémentaires encourus sur sa propre dette nationale.
Bien évidemment, les euro-bonds ne sont pas une panacée. Premièrement, le Pacte budgétaire en lui-même est un instrument mal conçu. L’introduction des euro-bonds apporterait un coup de fouet à la zone euro, mais il est possible que ce coup de fouet ne soit pas suffisant. Dans ce cas, une stimulation budgétaire et monétaire serait nécessaire. Pour autant, une telle difficulté constituerait un véritable luxe.
Deuxièmement, l’Union européenne a également besoin d’une union bancaire, et finalement d’une union politique. Le sauvetage de Chypre a encore davantage accentué ces besoins, en remettant en cause le modèle d’entreprise des banques européennes, qui dépendent largement des gros dépôts.
La principale limite des euro-bonds réside dans le fait qu’ils ne sont pas de nature à faire disparaître les écarts de compétitivité. Il serait toujours nécessaire pour chaque État d’entreprendre des réformes structurelles. Ceux qui manqueront de le faire risqueraient de voir se former en leur sein des poches permanentes de pauvreté et de dépendance, semblables à celles qui persistent dans de nombreux pays riches. Il leur faudrait alors survivre grâce au soutien limité des Fonds structurels européen et autres aides. Néanmoins, une acceptation allemande de ces euro-bonds transformerait totalement l’atmosphère politique, et faciliterait l’adoption de réformes structurelles qui sont également nécessaires.
Reste qu’une grande majorité d’Allemands est farouchement opposée aux euro-bonds. Depuis que la chancelière Merkel a opposé son véto aux euro-bonds, les arguments du type de ceux que je fais valoir aujourd’hui n’ont même pas été considérés. L’opinion ne réalise pas combien le prix du consentement aux euro-bonds serait bien inférieur à celui d’une démarche ne consistant qu’à fournir un effort minimum pour préserver l’euro.
Il appartient ainsi à l’Allemagne de décider si elle souhaite ou non consentir aux euro-bonds. Mais elle n’a pas le droit d’empêcher les pays lourdement endettés de s’extraire de leur misère en s’unissant pour émettre des euro-bonds. En d’autres termes, si l’Allemagne entend s’opposer définitivement aux euro-bonds, elle devrait envisager de quitter la zone euro, pour permettre aux autres États de les mettre en place.
Étonnamment, dans l’hypothèse d’un tel départ, la comparaison des euro-bonds émis par une zone euro sans Allemagne avec les obligations américaines, britanniques et japonaises jouerait toujours en faveur des euro-bonds. La dette nette de ces trois pays, par rapport à leur PIB, est en réalité plus élevée que celle d’une zone euro sans Allemagne.
Ce résultat étonnant s’explique lorsque l’on compare les conséquences d’un éventuel départ de l’Allemagne à celles de l’hypothétique sortie d’un État lourdement endetté comme par exemple l’Italie.
Dans la mesure où l’ensemble de la dette accumulée est libellée en euro, le fait de savoir quel État est en charge de l’euro peut faire toute la différence. En cas de départ de l’Allemagne, l’euro se déprécierait. Les pays débiteurs retrouveraient leur compétitivité. Leur dette diminuerait de manière réelle et, s’ils étaient en mesure d’émettre des euro-bonds, le risque de défaut disparaîtrait. Leur dette deviendrait soudainement viable. La majeure partie du fardeau de l’ajustement reviendrait aux États ayant quitté l’euro. Leurs exportations deviendraient moins compétitives, et ils rencontreraient sur leurs marchés nationaux une forte concurrence issue de la zone euro. Ils connaîtraient également des pertes sur leurs créances et leurs investissements libellés en euro. La mesure de ces pertes dépendrait de l’ampleur de la dépréciation ; ces États auraient ainsi intérêt à contenir la dépréciation à l’intérieur des frontières. Après un certain nombre de dislocations initiales, le résultat final serait la réalisation du rêve de John Maynard Keynes, celui d’un système monétaire international dans lequel créanciers et débiteurs partageraient la responsabilité du maintien de la stabilité. L’Europe échapperait alors à la menace de dépression.
En revanche, en cas de départ de l’Italie, la charge de la dette du pays libellée en euro deviendrait écrasante, et il serait nécessaire de procéder à une restructuration. Ceci plongerait le reste de l’Europe, ainsi que le reste du monde, dans un effondrement financier, qui pourrait bien dépasser la capacité des autorités monétaires à le contenir. L’écroulement de l’euro conduirait alors certainement à une désintégration chaotique de l’Union européenne, et l’Europe se retrouverait dans une situation bien pire que celle qui était la sienne lorsqu’elle s’engagea dans cette noble expérience de création d’une Union européenne.
Bien évidemment, il serait préférable que l’Allemagne quitte l’euro plutôt que l’Italie, tout comme il serait bien sûr préférable que l’Allemagne accepte les euro-bonds plutôt que de quitter l’euro. L’ennui, c’est que l’Allemagne n’est pas contrainte de faire un choix, disposant d’une autre alternative : elle peut poursuivre sa ligne de conduite actuelle consistant à ne fournir rien de plus qu’un effort minimum pour préserver l’euro.
Si mon analyse est correcte, cette ligne de conduite ne constitue pas la meilleure alternative pour l’Allemagne, excepté à très court terme. À mesure que la situation se détériore, cette situation est vouée à devenir écrasante. Plus les Allemands tarderont, plus lourds seront les dégâts. C’est pourtant aujourd’hui le choix privilégié de l’Allemagne, au moins jusqu’aux élections.
Il est capital que l’Allemagne procède à un choix définitif entre une acceptation des euro-bonds et un départ de la zone euro. C’est là l’argument que j’ai souhaité développer aujourd’hui.
J’ai longtemps et profondément réfléchi sur la question de savoir si je devais faire valoir mon argumentation dès aujourd’hui, ou plutôt attendre la fin des élections. J’ai finalement décidé d’agir immédiatement, sur la base de deux considérations. Premièrement, les événements revêtent une dynamique certaine, et la crise est ainsi vouée à s’aggraver chaque jour jusqu’aux élections. Le sauvetage de Chypre m’a donné raison. Deuxièmement, mon interprétation est si radicalement différente du point de vue prévalant en Allemagne qu’il lui faudra du temps pour être comprise. J’ai donc pensé qu’il était préférable de la faire valoir le plus tôt possible.
Permettez-moi de synthétiser mon argumentation. Je considère que l’Europe se porterait mieux si l’Allemagne procédait à un choix entre les euro-bonds et une sortie de la zone euro, plutôt que de poursuivre dans la ligne de conduite actuelle consistant à ne fournir que le minimum pour maintenir l’euro en vie. Et l’Europe se porterait mieux quelle que soit la décision de l’Allemagne. De plus, ceci vaut non seulement pour l’Europe mais également pour l’Allemagne, excepté à très court terme.
En revanche, quant à savoir laquelle des deux alternatives est préférable pour l’Allemagne, la réponse apparaît moins évidente. Il appartient aux électeurs allemands de décider. Il est clair que si un referendum était organisé aujourd’hui, les eurosceptiques le remporteraient haut la main. Une prise de conscience plus profonde pourrait cependant faire changer d’avis le peuple. Les Allemands pourraient ainsi réaliser combien le prix d’une autorisation allemande des euro-bonds a été exagéré, et combien le prix d’une sortie de la zone euro a été sous-estimé.
Ma préférence personnelle s’oriente vers l’autorisation des euro-bonds, mon second choix vers une sortie allemande de la zone euro. Mais quelle que soit la décision prise, un tel choix sera infiniment plus favorable qu’une absence de décision qui perpétuerait la crise. Le pire scénario serait celui du départ d’un des États débiteurs comme l’Italie, dans la mesure où il conduirait à une dissolution désordonnée de l’Union européenne.
J’ai aujourd’hui formulé un certain nombre d’arguments surprenants, et notamment l’idée selon laquelle les euro-bonds fonctionneraient encore mieux sans l’Allemagne. Mes amis pro-européens n’en croient pas leurs oreilles. Ils ne peuvent imaginer l’euro sans l’Allemagne. Je pense néanmoins qu’ils confondent euro et Union européenne. L’un et l’autre sont deux choses distinctes. L’Union européenne est l’objectif, et l’euro l’un des moyens de parvenir à une fin. Ainsi, l’euro ne devrait pas pouvoir détruire l’Union européenne.
Il se peut toutefois que mon analyse s’avère trop rationnelle. Union européenne et euro se confondent non seulement dans l’imaginaire collectif, mais également dans la loi. Il est donc possible que l’Union européenne ne puisse survivre à une sortie allemande de la zone euro. Dans ce cas, il nous faut faire tout notre possible pour persuader l’opinion allemande de s’affranchir d’un certain nombre de préjugés et d’idées fausses fortement ancrés, et de consentir aux euro-bonds.
J’aimerais enfin faire valoir combien l’Union européenne est importante non seulement pour l’Europe, mais également pour le monde entier. L’UE a été créée pour incarner les principes d’une société ouverte. Ceci signifie que la connaissance parfaite n’existe pas. Nul n’est exempt de préjugés et d’idées fausses ; nul ne doit se voir reprocher ses erreurs. La critique, ou la Schuld, n’apparaît que lorsqu’une erreur ou une idée reçue est identifiée sans être corrigée, trahissant alors les principes sur lesquels l’Union européenne s’est construite. C’est dans cet état d’esprit qu’il appartient à l’Allemagne de consentir aux euro-bonds, et de sauver l’Union européenne.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
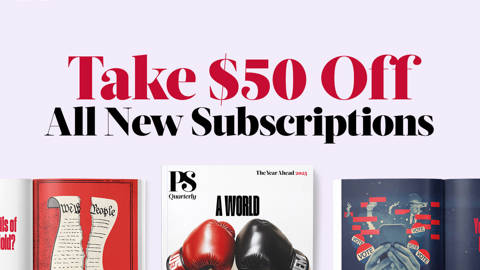








Ce qui suit est une version étendue de l'article de George Soros "Choix d'Allemagne".
L’objectif de ma venue ici aujourd’hui est d’aborder la crise de l’euro. Au vu des récents événements, je pense que vous serez d’accord sur le fait que cette crise est loin d’être résolue. Elle a d’ores et déjà causé des dommages considérables sur le plan financier et politique, et engendré un impact humain immense. Cette crise a également transformé l’Union européenne en une entité radicalement différente de ce à quoi elle se destinait à l’origine. L’Union européenne a toujours eu pour vocation de constituer une association volontaire d’États égaux, mais la crise l’a changée en un ensemble hiérarchique, chapeauté par l’Allemagne et par d’autres pays créanciers, en charge du sort d’États lourdement endettés, relégués à un statut de deuxième classe. Bien que l’Allemagne ne soit en mesure de dicter une quelconque politique, aucune de ces politiques ne peut en pratique être proposée sans avoir obtenu l’accord préalable de l’Allemagne. Aggravant encore la situation, la politique d’austérité mise en avant par l’Allemagne a pour effet de prolonger la crise et de perpétuer la subordination des pays débiteurs.
Cette situation aboutit à des tensions politiques, comme en témoigne l’impasse politique en Italie. Les Italiens sont désormais en majorité opposés à l’euro, et il est très probable que cette tendance s’accentue. Il existe désormais un réel danger de voir la crise de l’euro finir par anéantir l’Union européenne. Une désintégration désordonnée laisserait l’Europe dans un état encore plus grave qu’à l’époque où fut entreprise cette démarche audacieuse de création d’une Union européenne. Nous assisterions à une tragédie d’ampleur historique. Cette menace ne peut être surmontée qu’à travers le leadership allemand. L’Allemagne n’a jamais souhaité occuper une position dominante, et a toujours été réticente à accepter les responsabilités et les obligations liées à un tel statut. C’est l’une des raisons qui expliquent l’émergence de la situation actuelle. Mais qu’elle le veuille ou non, l’Allemagne est bel et bien aux commandes, et c’est ce qui m’amène à venir m’exprimer ici aujourd’hui.
Comment l’Europe en est-elle arrivée à un tel désastre ? Et comment peut-elle s’en extraire ? Telles sont les deux questions que je souhaite aborder. La réponse à la première de ces interrogations est extrêmement compliquée, compte tenu du caractère profondément complexe de la crise de l’euro. Celle-ci revêt en effet une dimension à la fois politique et financière. Et cette dimension financière se décline elle-même en trois composantes au moins : crise de la dette souveraine, crise bancaire, et écarts de compétitivité. Ces différents aspects sont par ailleurs interconnectés, ce qui soulève des problématiques si épineuses qu’elles en deviennent un véritable casse-tête. Je considère que la crise de l’euro ne peut être pleinement comprise sans prise en compte du rôle considérable qu’ont joué les erreurs et les malentendus dans sa création. Cette crise a en effet été presque entièrement auto-infligée. Elle revêt en ce sens une nature cauchemardesque.
La réponse à la deuxième question est en revanche extrêmement simple. En effet, lorsque les problèmes sont clairement compris, la solution émerge quasiment d’elle-même.
Je développerai les raisons pour lesquelles je considère que l’Allemagne est en grande partie responsable des erreurs de politiques qui ont engendré la crise. Mais j’aimerais d’ores et déjà préciser clairement que je n’entends nullement faire le procès de l’Allemagne. Quiconque aurait été aux affaires aurait commis les mêmes erreurs. Je puis vous affirmer, sur la base de mon expérience personnelle, que nul n’aurait été en mesure de comprendre la situation dans toute sa complexité au moment où elle s’est jouée.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
Je réalise pleinement combien je risque de vous contrarier en mettant en cause la responsabilité de l’Allemagne. Mais sachez que seule l’Allemagne est en capacité de régler la situation. Je suis un fervent partisan de l’Union européenne, et je ne souhaite pas la voir disparaître. Je m’inquiète également des souffrances humaines immenses et inutiles qu’entraîne la crise de l’euro, et j’entends faire tout mon possible pour les atténuer. Mon interprétation de la crise de l’euro est par ailleurs tout à fait différente des conceptions qui prévalent en Allemagne. J’espère, en vous suggérant un point de vue différent, pouvoir vous encourager à reconsidérer les vôtres avant que davantage de dégâts ne soient causés. C’est là le but de ma venue parmi vous.
Dès sa création, l’Union européenne fut un projet audacieux suscitant l’enthousiasme dans l’imaginaire de nombreuses personnes, y compris dans le mien. Je considérai l’Union européenne comme l’incarnation d’une société ouverte – une association volontaire d’États égaux cédant une partie de leur souveraineté dans l’objectif du bien commun. L’Union européenne réunissait alors cinq grands États membres accompagnés d’un certain nombre de petits États, tous ces pays embrassant les principes de la démocratie, des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la primauté du droit. Aucune de ces nations ou nationalités n’occupait de position dominante.
Le processus d’intégration fut emmené par une poignée d’hommes d’État visionnaires qui, conscients de l’impossibilité d’atteindre la perfection, pratiquèrent ce que Karl Popper a appelé l’ingénierie sociale fragmentaire. Ils se fixèrent des objectifs limités et des échéances fermes, pour ensuite mobiliser la volonté politique dans le sens d’un petit pas en avant, sachant pertinemment qu’une fois ce pas franchi, son caractère insuffisant apparaîtrait évident et exigerait un pas supplémentaire. Ce processus se nourrit de son propre succès, à la manière d’une séquence d’expansion-récession sur les marchés financiers. C’est ainsi que la Communauté européenne du charbon et de l’acier s’est peu à peu transformée en Union européenne, étape par étape.
La France et l’Allemagne furent en première ligne de cet effort. Lorsque l’empire soviétique commença à se désintégrer, les dirigeants allemands comprirent que la réunification ne serait possible que dans le contexte d’une Europe plus unie, et se préparèrent à faire des sacrifices considérables en ce sens. Lorsqu’il s’agissait de négocier, ils étaient systématiquement disposés à apporter une contribution un peu supérieure et à demander un peu moins que les autres, facilitant ainsi les accords. À l’époque, les responsables politiques allemands affirmaient que l’Allemagne ne menait aucune politique étrangère indépendante, mais seulement une politique étrangère européenne. Ceci permit une accélération exceptionnelle du processus. Un processus qui aboutit à la réunification de l’Allemagne en 1990 et à la ratification du Traité de Maastricht en 1992. S’en suivit une période de consolidation qui perdura jusqu’à la crise financière de 2007-2008.
Malheureusement, le Traité de Maastricht présentait une faille fondamentale. Les architectes de l’euro reconnaissaient qu’il y avait là une construction incomplète : une union monétaire sans union politique. Ces architectes avaient pour autant des raisons de croire que lorsque le besoin s’en ferait sentir, la volonté politique de franchir une nouvelle étape pourrait être mobilisée. Il s’agissait en effet de la manière dont le processus d’intégration avait toujours fonctionné jusqu’à lors.
L’euro revêtait toutefois de nombreuses autres défaillances, dont ni les architectes ni les États membres n’étaient pleinement conscients. Le Traité de Maastricht considérait par exemple comme acquise l’idée que seul le secteur public pourrait produire des déficits chroniques, puisque le secteur privé pourrait toujours être en mesure de corriger ses propres excès. La crise financière de 2007-2008 démentit cette idée. Elle révéla également une défaillance presque fatale dans la construction de l’euro : en créant une banque centrale indépendante, les États membres sont devenus endettés dans une monnaie qu’ils ne contrôlent pas. Ceci les a exposés au risque de défaut.
Les pays développés n’ont aucune raison de connaître un défaut ; ils peuvent toujours imprimer de l’argent. Leur monnaie est susceptible de se déprécier en valeur, mais le risque de défaut est pratiquement inexistant. En revanche, les pays moins développés contraints d’emprunter dans une devise étrangère courent un risque de défaut. Pour aggraver encore la situation, les marchés financiers sont susceptibles de pousser de tels États vers un défaut au travers de raids baissiers. Ce risque de défaut a relégué certains États membres au statut de pays du Tiers monde surendettés dans une devise étrangère.
Avant la crise financière de 2007-2008, autorités et marchés financiers ignoraient cette caractéristique de l’euro. Lorsque l’euro est apparu, les obligations étatiques étaient considérées sans risque. Les régulateurs ont permis aux banques commerciales d’acquérir des obligations étatiques à hauteur de montants illimités, sans mettre de côté aucun capital-risque, et la Banque centrale européenne a accepté toutes les obligations étatiques selon son escompte officiel et en des termes égaux. Ceci a de manière perverse incité les banques commerciales à accumuler les obligations des États membres les plus faibles, soumis à des taux plus élevés dans le but de gagner quelques points de base supplémentaires. Ainsi, les différentiels de taux d’intérêt entre les différentes obligations étatiques ont pratiquement disparu.
Cette convergence des taux d’intérêt a entraîné d’un autre côté une divergence de la performance économique. Les pays qualifiés d’États périphériques, au premier rang desquels l’Espagne et l’Irlande, ont connu des booms de l’immobilier, de l’investissement et de la consommation, qui les ont rendus moins compétitifs, tandis que l’Allemagne, plombée par le coût de la réunification, a initié des réformes structurelles de grande envergure, notamment à l’égard du marché du travail, qui l’ont rendue plus compétitive.
Au cours de la semaine ayant suivi la faillite de Lehman Brothers, les marchés financiers mondiaux ont littéralement cessé de fonctionner, et ont dû être placés sous assistance respiratoire. Il a pour cela été nécessaire de remplacer le crédit des institutions financières à l’égard desquelles la confiance était altérée par un crédit souverain (sous la forme de garanties de la Banque centrale et de déficits budgétaires). Cet accent mis sur la dette souveraine a révélé une caractéristique de l’euro jusqu’à lors ignorée, à savoir le fait qu’en créant une banque centrale indépendante, les États membres de l’euro avaient concédé une partie de leur souveraineté.
Cela aurait été le bon moment pour franchir une étape supplémentaire vers une union budgétaire autant que monétaire, mais la volonté politique a fait défaut. L’Allemagne, tirée vers le bas par le prix de sa réunification, n’était plus à l’avant-garde de l’intégration. La chancelière Merkel a très bien cerné l’opinion publique en affirmant que chaque État devait s’occuper de ses propres institutions financières plutôt que de voir l’Union européenne les gérer de manière collective. Cette période fut celle d’un retour en arrière. Rétrospectivement, elle marqua le début du processus de désintégration.
Plus d’une année fut nécessaire aux marchés financiers pour prendre conscience des implications de la déclaration de la chancelière Merkel, démontrant combien les marchés eux aussi opèrent sur la base de connaissances loin d’être parfaites. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2009, lorsque l’ampleur du déficit grec a été révélée, que les marchés financiers ont réalisé qu’un État membre risquait bel et bien le défaut. Les marchés ont ainsi par vengeance rehaussé les primes de risque à l’égard des États les plus fragiles. Ceci a rendu potentiellement insolvables les banques commerciales dont les bilans étaient remplis de telles obligations, et engendra à la fois une crise de la dette souveraine et une crise bancaire. L’une et l’autre sont en effet aussi liées que deux sœurs jumelles.
Il existe un parallèle étroit entre la crise de l’euro et la crise bancaire internationale de 1982. À l’époque, le FMI et les autorités bancaires internationales avaient sauvé le système bancaire mondial en prêtant juste assez d’argent aux États lourdement endettés pour leur permettre d’échapper au défaut, les poussant toutefois un peu plus vers une dépression durable. L’Amérique latine a, à cet égard, perdu dix ans.
L’Allemagne joue aujourd’hui le même rôle que le FMI à l’époque. Les circonstances sont certes différentes, mais les effets sont les mêmes. Les créanciers déplacent en effet la charge de l’ajustement vers les pays débiteurs, et se dérobent quant à leur responsabilité à l’égard des déséquilibres. Il est intéressant de constater que les termes « centre » et « périphérie » se sont glissés dans l’usage commun de manière presque inaperçue, bien qu’il soit, en termes politiques, clairement inapproprié de décrire l’Italie et l’Espagne comme la périphérie de l’Union européenne. Le fait est, cependant, que l’euro a fait de leurs obligations étatiques des obligations semblables à celles de pays du Tiers monde et susceptibles d’engendrer un défaut. Cet aspect a longtemps été ignoré par les autorités, et n’est encore aujourd’hui pas pleinement admis. C’est là la véritable cause originelle de la crise de l’euro.
Comme ce fut le cas dans les années 1980, toute la critique et toute la charge est retombée sur la « périphérie, » et la responsabilité du « centre » n’a jamais été proprement admise. Les États périphériques se voient reprocher leur manque de discipline budgétaire et d’éthique du travail, mais cela ne suffit pas. Il est certes nécessaire que les États de la périphérie procèdent à des réformes structurelles, comme le fit l’Allemagne après sa réunification. Pour autant, ignorer que l’euro lui-même présente des problèmes structurels qui doivent être corrigés revient à ignorer la cause profonde de la crise de l’euro. C’est pourtant ce à quoi nous assistons.
C’est ici que le terme allemand « Schuld » joue un rôle clé. Comme vous le savez, il signifie à la fois dette, responsabilité, ou encore culpabilité. Son utilisation a rendu naturel – ou « selbstverständlich » – pour l’opinion publique allemande d’accuser les États lourdement endettés de leur propre infortune. Le fait que la Grèce ait manifestement violé les règles a contribué à cet état d’esprit. Or, d’autres États comme l’Espagne et l’Irlande ont joué selon les règles ; il fut un temps où l’Espagne était en effet présentée comme un modèle de vertu. De toute évidence, les fautes sont de nature systémiques, et le malheur des pays lourdement endettés découle en grande partie des règles régissant l’euro. C’est cet argument que j’aimerais faire entendre aujourd’hui.
Selon moi, la « Schuld » ou la responsabilité du « centre » est encore plus grande aujourd’hui qu’elle ne le fut lors de la crise bancaire de 1982. Peut-être était-il été politiquement acceptable en 1982 d’imposer l’austérité aux pays moins développés afin de sauver le système financier international. Pour autant, une telle démarche à l’égard de la zone euro est aujourd’hui incompatible avec cette idée d’une Union européenne qui constituerait une association volontaire d’États égaux. Il existe un conflit insolvable entre ce que dicte la nécessité financière et ce qui est politiquement acceptable. C’est là une question qu’auraient dû aborder les dernières élections italiennes.
La charge de cette responsabilité incombe principalement à l’Allemagne. La Bundesbank a contribué à concevoir le schéma directeur de l’euro, dont les défaillances ont amené l’Allemagne à garder les commandes. Ceci a créé deux problématiques. La première est politique, la seconde financière. C’est la combinaison des deux qui a rendu la situation si épineuse.
La problématique politique réside dans le fait que l’Allemagne n’a jamais souhaité occuper la position dominante qui lui a été conférée, et dans sa réticence à accepter les obligations et les responsabilités attachées à une telle position. L’Allemagne ne souhaite pas jouer le rôle de « tirelire » de l’euro, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle déploie ainsi juste suffisamment d’efforts pour éviter un défaut, mais rien de plus, et lorsque la pression issue des marchés financiers se relâche, elle cherche systématiquement à resserrer les conditions d’octroi d’un tel soutien.
La problématique financière réside quant à elle dans le fait que l’Allemagne impose les mauvaises politiques à la zone euro. L’austérité ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas réduire le fardeau de la dette en réduisant le déficit budgétaire. Le fardeau de la dette est un ratio calculé sur la base de la dette accumulée et du PIB, tous deux exprimés en termes nominaux. Et dans un contexte de demande inadéquate, les réductions budgétaires entraînent une réduction plus que proportionnelle du PIB – en termes techniques, ce que l’on appelle le multiplicateur budgétaire est supérieur à un.
L’opinion publique allemande a du mal à comprendre cela. Les réformes budgétaires et structurelles menées en 2006 par le gouvernement Schroeder ont en effet fonctionné ; pourquoi ne fonctionneraient-elles pas quelques années plus tard pour la zone euro ? La réponse réside dans le fait que l’austérité fonctionne en augmentant les exportations tout en réduisant les importations. Or, lorsque tout le monde effectue la même démarche, cela ne fonctionne tout simplement pas.
La crise de l’euro a atteint son apogée à l’été dernier. Les marchés financiers ont commencé à anticiper une rupture possible, et les primes de risque ont atteint des niveaux écrasants. En dernier recours, la chancelière Merkel a approuvé la nomination du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, contre son propre candidat, Jens Weidmann. Draghi a su saisir tout l’enjeu de la situation. Il a en effet déclaré que la BCE ferait « tout le nécessaire » pour protéger l’euro, une volonté qu’il a appuyée par l’introduction des fameuses OMT. Ceci a rassuré les marchés financiers, qui ont connu un véritable soulagement généralisé. Mais l’euphorie a été de courte durée. Dès lors que la pression des marchés financiers s’est relâchée, l’Allemagne a commencé à revenir sur les promesses qu’elle avait faites au plus haut de la crise.
Dans le cadre du sauvetage de Chypre, l’Allemagne est allée trop loin. Afin de minimiser le coût de ce sauvetage, elle a tenu à ce que les déposants chypriotes soient sollicités pour recapitaliser les banques. Cette décision a été prématurée. Si elle avait été prise après qu’une union bancaire ait été établie et que les banques aient été recapitalisées, il aurait pu s’agir d’une solution saine. Or, cette décision a eu lieu à une période où le système bancaire se retranchait en silos nationaux, et demeurait extrêmement vulnérable. Ce qui s’est passé à Chypre remet en cause le modèle d’entreprise des banques européennes, qui dépendent considérablement des dépôts. Jusqu’à présent, les autorités faisaient tout pour protéger les déposants. Chypre a changé cela. L’attention se concentre sur l’impact du sauvetage de Chypre, or l’impact sur le système bancaire est beaucoup plus important. Les banques vont devoir payer des primes de risque qui affecteront plus lourdement les banques les plus fragiles ainsi que celles des États les plus en difficulté. Le lien insidieux entre le coût de la dette souveraine et la dette bancaire s’en trouvera renforcé. La partie deviendra encore plus inéquitable qu’auparavant.
La chancelière Merkel aurait sans aucun doute souhaité mettre la crise de l’euro en attente au moins jusqu’aux prochaines élections, mais cette crise est de retour en force. L’opinion publique allemande ignore peut-être cela, dans la mesure où Chypre a constitué une victoire politique considérable pour la chancelière Merkel. Aucun pays n’ose défier sa volonté. Par ailleurs, l’Allemagne elle-même demeure relativement peu touchée par la dépression croissante qui envahit la zone euro. Je pense cependant que d’ici les élections, l’Allemagne sera elle aussi entrée en récession, et cela dans la mesure où la politique monétaire menée par la zone euro est en total décalage avec celles des principales autres monnaies. Les acteurs extérieurs procèdent à un assouplissement quantitatif. La Banque du Japon constituait jusqu’à récemment la dernière réticente, mais elle est dernièrement revenue sur ce refus. L’existence d’un yen plus faible, associée à la fébrilité de l’Europe, est vouée à affecter les exportations de l’Allemagne.
Si mon analyse est correcte, une solution simple émerge d’elle-même. Cette solution peut être résumée en un mot : les euro-bonds.
Les euro-bonds ne sont autres que des obligations conjointes et solidaires de tous les États membres. S’il était possible aux États qui se conforment au Pacte budgétaire de convertir l’intégralité de leur stock existant de dette étatique en euro-bonds, l’impact positif serait proche du miracle. Le risque de défaut disparaîtrait, de même que les primes de risque. Les bilans des banques bénéficieraient d’un coup de fouet immédiat, de même que les budgets des États lourdement endettés, dans la mesure où le coût de l’amortissement de leurs stocks de dette étatique existants s’en trouverait réduit. L’Italie, par exemple, pourrait économiser jusqu’à 4 % de son PIB. Son budget s’orienterait vers l’excédent, et, au lieu de l’austérité, le gouvernement pourrait procéder à des mesures de relance budgétaire. L’économie entrerait en croissance et le ratio de la dette diminuerait. La plupart des problèmes à priori insolubles s’évaporeraient littéralement. Seuls les écarts de compétitivité demeureraient non résolus. Il serait toujours nécessaire aux États, dans leur individualité, d’adopter des réformes structurelles, mais la principale défaillance structurelle de l’euro serait réglée. Nous nous réveillerions véritablement de ce cauchemar.
Le Pacte budgétaire établit un certain nombre de remparts adéquats contre le risque qu’implique toute obligation conjointe et solidaire. Conformément à ce Pacte budgétaire, les États auraient la possibilité d’émettre de nouveaux bons et de nouvelles obligations pour remplacer ceux arrivés à maturité, mais rien de plus ; au bout de cinq ans, l’encours de la dette serait progressivement ramené à 60% du PIB. Dans le cas où un État échouerait à se conformer aux règles, il serait alors pénalisé en voyant réduite la quantité d’euro-bonds qu’il lui serait permis d’émettre ; il serait alors nécessaire à cet État d’emprunter le solde en son nom propre, et de verser d’importantes primes de risque.
L’Allemagne s’oppose aux euro-bonds au motif qu’une fois ces euro-bonds introduits, il n’existerait aucune garantie que les États dits périphériques ne violent pas à nouveau les règles. Je considère cette crainte comme infondée. La menace de perdre le privilège d’émission des euro-bonds et de payer de lourdes primes de risque encouragerait en effet puissamment les États à se conformer aux règles. La pénalité serait effectivement si douloureuse qu’il lui faudrait être imposée avec beaucoup de mesure pour ne pas aggraver trop brusquement la position financière d’un État. Dans le même temps, l’autorité budgétaire compétente exercerait des contrôles plus stricts, et toute désobéissance serait punie par de nouvelles réductions du nombre d’euro-bonds pouvant être émis. Aucun gouvernement ne pourrait résister à une telle pression.
Il règne également de larges craintes selon lesquelles les euro-bons seraient de nature à ruiner la cote de crédit de l’Allemagne. Les euro-bonds sont souvent comparés au Plan Marshall. Selon cette comparaison, l’argument voudrait que le Plan Marshall n’ait coûté que quelques points de pourcentage du PIB de l’Amérique alors que les euro-bonds coûteraient en revanche un multiple du PIB de l’Allemagne. Un tel argument revient à comparer des pommes avec des oranges. Le Plan Marshall a en effet constitué une dépense à proprement parler, tandis que les euro-bonds impliquent une garantie de nature à n’être jamais invoquée. Le prix d’une approbation allemande à l’égard des euro-bonds a ainsi été largement exagéré.
Toute garantie a ceci de particulier que plus elle est convaincante, et moins il est probable qu’elle soit invoquée. Les États-Unis ne se sont jamais vus contraints de rembourser la dette encourue lorsqu’ils ont converti la dette des États individuels en obligations fédérales. L’Allemagne a ceci de particulier qu’elle n’entend fournir qu’un effort minimum ; c’est la raison pour laquelle il lui a fallu multiplier ses engagements en escalade, et c’est pourquoi elle est confrontée à des pertes réelles. Le Pacte budgétaire, appuyé par une Autorité budgétaire fonctionnant correctement, permettrait d’éliminer pratiquement tout risque de défaut. La comparaison des euro-bonds avec les obligations américaines, britanniques et japonaises jouerait sur les marchés financiers en faveur des euro-bonds. Certes, l’Allemagne devrait alors payer davantage sur sa propre dette qu’elle ne le fait aujourd’hui, mais les rendements exceptionnellement faibles des Bunds sont un symptôme du mal dont souffre la périphérie. Le bénéfice indirect pour l’Allemagne découlerait du fait qu’une reprise à la périphérie dépasserait de très loin les coûts supplémentaires encourus sur sa propre dette nationale.
Bien évidemment, les euro-bonds ne sont pas une panacée. Premièrement, le Pacte budgétaire en lui-même est un instrument mal conçu. L’introduction des euro-bonds apporterait un coup de fouet à la zone euro, mais il est possible que ce coup de fouet ne soit pas suffisant. Dans ce cas, une stimulation budgétaire et monétaire serait nécessaire. Pour autant, une telle difficulté constituerait un véritable luxe.
Deuxièmement, l’Union européenne a également besoin d’une union bancaire, et finalement d’une union politique. Le sauvetage de Chypre a encore davantage accentué ces besoins, en remettant en cause le modèle d’entreprise des banques européennes, qui dépendent largement des gros dépôts.
La principale limite des euro-bonds réside dans le fait qu’ils ne sont pas de nature à faire disparaître les écarts de compétitivité. Il serait toujours nécessaire pour chaque État d’entreprendre des réformes structurelles. Ceux qui manqueront de le faire risqueraient de voir se former en leur sein des poches permanentes de pauvreté et de dépendance, semblables à celles qui persistent dans de nombreux pays riches. Il leur faudrait alors survivre grâce au soutien limité des Fonds structurels européen et autres aides. Néanmoins, une acceptation allemande de ces euro-bonds transformerait totalement l’atmosphère politique, et faciliterait l’adoption de réformes structurelles qui sont également nécessaires.
Reste qu’une grande majorité d’Allemands est farouchement opposée aux euro-bonds. Depuis que la chancelière Merkel a opposé son véto aux euro-bonds, les arguments du type de ceux que je fais valoir aujourd’hui n’ont même pas été considérés. L’opinion ne réalise pas combien le prix du consentement aux euro-bonds serait bien inférieur à celui d’une démarche ne consistant qu’à fournir un effort minimum pour préserver l’euro.
Il appartient ainsi à l’Allemagne de décider si elle souhaite ou non consentir aux euro-bonds. Mais elle n’a pas le droit d’empêcher les pays lourdement endettés de s’extraire de leur misère en s’unissant pour émettre des euro-bonds. En d’autres termes, si l’Allemagne entend s’opposer définitivement aux euro-bonds, elle devrait envisager de quitter la zone euro, pour permettre aux autres États de les mettre en place.
Étonnamment, dans l’hypothèse d’un tel départ, la comparaison des euro-bonds émis par une zone euro sans Allemagne avec les obligations américaines, britanniques et japonaises jouerait toujours en faveur des euro-bonds. La dette nette de ces trois pays, par rapport à leur PIB, est en réalité plus élevée que celle d’une zone euro sans Allemagne.
Ce résultat étonnant s’explique lorsque l’on compare les conséquences d’un éventuel départ de l’Allemagne à celles de l’hypothétique sortie d’un État lourdement endetté comme par exemple l’Italie.
Dans la mesure où l’ensemble de la dette accumulée est libellée en euro, le fait de savoir quel État est en charge de l’euro peut faire toute la différence. En cas de départ de l’Allemagne, l’euro se déprécierait. Les pays débiteurs retrouveraient leur compétitivité. Leur dette diminuerait de manière réelle et, s’ils étaient en mesure d’émettre des euro-bonds, le risque de défaut disparaîtrait. Leur dette deviendrait soudainement viable. La majeure partie du fardeau de l’ajustement reviendrait aux États ayant quitté l’euro. Leurs exportations deviendraient moins compétitives, et ils rencontreraient sur leurs marchés nationaux une forte concurrence issue de la zone euro. Ils connaîtraient également des pertes sur leurs créances et leurs investissements libellés en euro. La mesure de ces pertes dépendrait de l’ampleur de la dépréciation ; ces États auraient ainsi intérêt à contenir la dépréciation à l’intérieur des frontières. Après un certain nombre de dislocations initiales, le résultat final serait la réalisation du rêve de John Maynard Keynes, celui d’un système monétaire international dans lequel créanciers et débiteurs partageraient la responsabilité du maintien de la stabilité. L’Europe échapperait alors à la menace de dépression.
En revanche, en cas de départ de l’Italie, la charge de la dette du pays libellée en euro deviendrait écrasante, et il serait nécessaire de procéder à une restructuration. Ceci plongerait le reste de l’Europe, ainsi que le reste du monde, dans un effondrement financier, qui pourrait bien dépasser la capacité des autorités monétaires à le contenir. L’écroulement de l’euro conduirait alors certainement à une désintégration chaotique de l’Union européenne, et l’Europe se retrouverait dans une situation bien pire que celle qui était la sienne lorsqu’elle s’engagea dans cette noble expérience de création d’une Union européenne.
Bien évidemment, il serait préférable que l’Allemagne quitte l’euro plutôt que l’Italie, tout comme il serait bien sûr préférable que l’Allemagne accepte les euro-bonds plutôt que de quitter l’euro. L’ennui, c’est que l’Allemagne n’est pas contrainte de faire un choix, disposant d’une autre alternative : elle peut poursuivre sa ligne de conduite actuelle consistant à ne fournir rien de plus qu’un effort minimum pour préserver l’euro.
Si mon analyse est correcte, cette ligne de conduite ne constitue pas la meilleure alternative pour l’Allemagne, excepté à très court terme. À mesure que la situation se détériore, cette situation est vouée à devenir écrasante. Plus les Allemands tarderont, plus lourds seront les dégâts. C’est pourtant aujourd’hui le choix privilégié de l’Allemagne, au moins jusqu’aux élections.
Il est capital que l’Allemagne procède à un choix définitif entre une acceptation des euro-bonds et un départ de la zone euro. C’est là l’argument que j’ai souhaité développer aujourd’hui.
J’ai longtemps et profondément réfléchi sur la question de savoir si je devais faire valoir mon argumentation dès aujourd’hui, ou plutôt attendre la fin des élections. J’ai finalement décidé d’agir immédiatement, sur la base de deux considérations. Premièrement, les événements revêtent une dynamique certaine, et la crise est ainsi vouée à s’aggraver chaque jour jusqu’aux élections. Le sauvetage de Chypre m’a donné raison. Deuxièmement, mon interprétation est si radicalement différente du point de vue prévalant en Allemagne qu’il lui faudra du temps pour être comprise. J’ai donc pensé qu’il était préférable de la faire valoir le plus tôt possible.
Permettez-moi de synthétiser mon argumentation. Je considère que l’Europe se porterait mieux si l’Allemagne procédait à un choix entre les euro-bonds et une sortie de la zone euro, plutôt que de poursuivre dans la ligne de conduite actuelle consistant à ne fournir que le minimum pour maintenir l’euro en vie. Et l’Europe se porterait mieux quelle que soit la décision de l’Allemagne. De plus, ceci vaut non seulement pour l’Europe mais également pour l’Allemagne, excepté à très court terme.
En revanche, quant à savoir laquelle des deux alternatives est préférable pour l’Allemagne, la réponse apparaît moins évidente. Il appartient aux électeurs allemands de décider. Il est clair que si un referendum était organisé aujourd’hui, les eurosceptiques le remporteraient haut la main. Une prise de conscience plus profonde pourrait cependant faire changer d’avis le peuple. Les Allemands pourraient ainsi réaliser combien le prix d’une autorisation allemande des euro-bonds a été exagéré, et combien le prix d’une sortie de la zone euro a été sous-estimé.
Ma préférence personnelle s’oriente vers l’autorisation des euro-bonds, mon second choix vers une sortie allemande de la zone euro. Mais quelle que soit la décision prise, un tel choix sera infiniment plus favorable qu’une absence de décision qui perpétuerait la crise. Le pire scénario serait celui du départ d’un des États débiteurs comme l’Italie, dans la mesure où il conduirait à une dissolution désordonnée de l’Union européenne.
J’ai aujourd’hui formulé un certain nombre d’arguments surprenants, et notamment l’idée selon laquelle les euro-bonds fonctionneraient encore mieux sans l’Allemagne. Mes amis pro-européens n’en croient pas leurs oreilles. Ils ne peuvent imaginer l’euro sans l’Allemagne. Je pense néanmoins qu’ils confondent euro et Union européenne. L’un et l’autre sont deux choses distinctes. L’Union européenne est l’objectif, et l’euro l’un des moyens de parvenir à une fin. Ainsi, l’euro ne devrait pas pouvoir détruire l’Union européenne.
Il se peut toutefois que mon analyse s’avère trop rationnelle. Union européenne et euro se confondent non seulement dans l’imaginaire collectif, mais également dans la loi. Il est donc possible que l’Union européenne ne puisse survivre à une sortie allemande de la zone euro. Dans ce cas, il nous faut faire tout notre possible pour persuader l’opinion allemande de s’affranchir d’un certain nombre de préjugés et d’idées fausses fortement ancrés, et de consentir aux euro-bonds.
J’aimerais enfin faire valoir combien l’Union européenne est importante non seulement pour l’Europe, mais également pour le monde entier. L’UE a été créée pour incarner les principes d’une société ouverte. Ceci signifie que la connaissance parfaite n’existe pas. Nul n’est exempt de préjugés et d’idées fausses ; nul ne doit se voir reprocher ses erreurs. La critique, ou la Schuld, n’apparaît que lorsqu’une erreur ou une idée reçue est identifiée sans être corrigée, trahissant alors les principes sur lesquels l’Union européenne s’est construite. C’est dans cet état d’esprit qu’il appartient à l’Allemagne de consentir aux euro-bonds, et de sauver l’Union européenne.
Traduit de l’anglais par Martin Morel